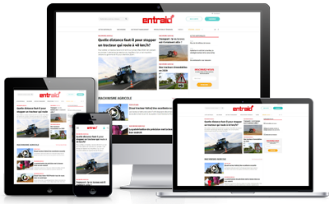Jusqu’à il y a dix ans, la cuma la Plaine, située à Saint-Aubin dans le Jura, avait pour seule activité, le traitement du maïs contre la pyrale. Mais lorsque le produit n’a été homologué qu’à demi-dose et que les trichogrammes ont fait leur apparition, l’activité se voyait dépérir, et la cuma avec. Une nouvelle stratégie portée par la cuma : investir dans des castreuses de maïs. Retour sur cette étape importante pour la coopérative.
Vers le maïs semences
En parallèle, les productions de ce secteur ont dû évoluer. Fini la culture légumière, la coopérative Daucy décide de quitter ce bassin de production. « Face à cela, ValUnion (l’union des coopératives de territoire, NDLR), a lancé une filière de semences de maïs en 2013, se souvient Patrick Mougeot, secrétaire de la cuma. Pour cela, les techniciens se sont formés à cette nouvelle culture et la coopérative a investi dans de nombreuses machines. Le deal, c’était qu’au bout de trois campagnes, les agriculteurs rachètent le matériel de récolte des semences. »
C’est ainsi qu’en 2016, la cuma a décidé d’investir dans ce matériel bien spécifique. « Nous leur avons acheté trois de leurs castreuses au prix de 35 000 € chacune, ajoute le secrétaire. C’était le prix de la valeur nette comptable. Neuves, elles valaient environ 50 000 €. » Ce sont des machines de quatre rangs équipées de pneus et de couteaux, au choix de l’agriculteur.
Pour compléter la gamme, le groupe de seize adhérents décide d’adapter une de leurs machines de traitement de maïs. Moins utilisée à l’époque et sans aucune valeur de revente, cela semble une bonne idée. Montant de la transformation : 15 000 €.
Éviter les déplacements avec les nouvelles castreuses de maïs
De suite, l’organisation des chantiers se met en place. Le groupe se répartit les quatre machines selon leur secteur de culture. Chacune d’elles a son responsable qui la loge. Si les surfaces varient chaque année, en moyenne, une machine castre environ 70 ha. Soit environ 280 ha chaque année, répartis sur un rayon d’une dizaine de kilomètres. « Nous évitons de déplacer les machines d’un secteur à l’autre, sauf s’il y a un coup de bourre ou une panne, explique Patrick Mougeot. Les adhérents doivent castrer entre cinq et quarante hectares, cela dépend des contrats avec la coopérative. »
Ce sont des machines relativement simples, mais utilisées sur seulement deux semaines. C’est pour cette raison que le groupe a investi dans quatre machines. Favorisant ainsi la disponibilité et la souplesse des chantiers. « Elles ne sont pas équipées d’adaptateur de hauteur de la plante, poursuit le secrétaire de la cuma. Alors, on a décidé que chacun des adhérents conduirait la machine. »
Affaire sérieuse
Parce qu’on ne rigole pas avec la castration du maïs. C’est une étape importante qui demande un savoir-faire, une technicité et une attention. « On n’a pas le droit à l’erreur », rappelle l’agriculteur. Pour cela, les agriculteurs effectuent au moins deux passages avec la castreuse :
- Un, voire deux, avec les couteaux ;
- Un avec les pneus.
« Le changement des têtes de castreuse se fait assez rapidement, estime-t-il. Deux de nos machines sont équipées de têtes hydrauliques et deux sont en demi-tour. Un peu plus chronophage. »
Après cela, la finition s’effectue à la main. Tous les agriculteurs de la cuma adhèrent au groupement d’employeurs du Jura et embauchent ponctuellement une équipe d’une dizaine de personnes. Question de simplicité. « Nous ne voulions pas gérer de main-d’œuvre à la cuma, reconnaît le secrétaire. Le travail que nous demandons est ponctuel et dépend beaucoup de la météo et du stade de développement de la plante. Il faut pouvoir s’appuyer sur de la main-d’œuvre réactive et consciencieuse. »
Prix fixe des castreuses de maïs
Pour ce qui est du prix, chaque adhérent paye 110 €/ha chaque année. Quelle que soit la machine, le type de tête utilisé ou encore le nombre de passages. « Le carburant et la main-d’œuvre sont à la charge de l’adhérent. Mais on ne consomme pas beaucoup. Il faut compter environ 2 l/ha », souligne Patrick Mougeot.
Tous les printemps, les quatre castreuses de maïs sont passées au crible. « On fait un état des lieux du matériel, on prévoit la vidange et le renouvellement des couteaux ou pneus, énumère Patrick Mougeot. Si l’entretien est trop complexe, on fait appel à un mécanicien extérieur. Mais de manière générale, les coûts d’entretien sont faibles. »
Ces retrouvailles sont aussi le moment d’organiser les chantiers de l’année. Pour cela, la cuma s’adosse à la coopérative. Conjointement, ils gèrent ensemble :
- Les surfaces ;
- Les isolements ;
- Les protocoles de semis ;
- Les plannings de la récolte.
Étaler les chantiers avec les castreuses de maïs
« Le technicien de la coopérative connaît notre organisation. Grâce à ce partenariat, nous arrivons à étaler les chantiers dans le temps, afin d’éviter les coups de bourre, précise le secrétaire. Ainsi, nous avons trois périodes de semis espacés de 15 jours. On reste dans l’opérationnel. Le président et le technicien s’échangent les infos des adhérents. » Les surfaces facturées sont donc connues, tout comme les dates de récolte.
« Ce partenariat est positif et essentiel dans l’organisation des chantiers, estime Patrick Mougeot. Même si on travaille chacun pour soi, on réfléchit collectivement afin de travailler au meilleur moment pour chacun d’entre nous. » Et il faut le dire, cet arrangement facilite le travail du président et accroît l’attractivité du poste.
Le traitement pyrale, un vieux souvenir
La cuma la Plaine a eu son âge d’or. Avant de se reporter sur l’activité de castration de maïs, elle rayonnait sur tout le département. « On traitait jusqu’à plus de 7 000 ha de maïs, se souvient Patrick Mougeot, président de la cuma à l’époque. Petit à petit, les surfaces de maïs se sont repliées en faveur du soja, du tournesol et des légumes. À cela s’est ajouté un changement de réglementation. »
Résultat, plus que 80 ha étaient traités en 2020. La cuma s’est retrouvée avec des machines invendables, mais a tout de même réussi à rembourser les 500 adhérents engagés à l’époque.
Un broyeur en commun
La cuma possède également un broyeur de maïs mâle, nécessaire lorsque le maïs femelle a été fécondé. De la marque Vermont, il est toujours attelé à un vieux tracteur de la cuma.
« Il était remboursé depuis longtemps et convient très bien à ce type de travail, estime Patrick Mougeot. Il est facturé 25 €/ha. »
Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :