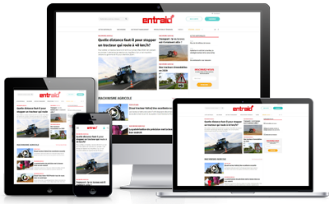Maillage, rebours et développement. Les installations de méthanisation se construisent toujours. Notamment en Bretagne qui verra son centième site d’injection entrer en service cette année. Pendant ce temps, les voies de circulation du gaz naturel s’adaptent à l’origine changeante du combustible et se préparent à cet essor encore à venir du biogaz. Retour sur le réseau GRDF et le biogaz en Bretagne.
La dynamique des projets de méthanisation en injection s’est relancée
En France, en 2024, 3,2 % du gaz consommé en France était du biogaz. En Bretagne, c’était même 7 %. Le gestionnaire du réseau de distribution GRDF détaille la trajectoire. « Avec la mise en service des projets actuels dans la région, nous estimons être à 14 % rapidement », explique David Colin, directeur territorial de GRDF en Bretagne. Particulièrement depuis la révision des systèmes tarifaires fin 2023, la dynamique de déploiement est là.
Au-delà de 2030 qui pose un jalon, à savoir 30 %, GRDF prévoit que la production régionale de biométhane représente, voire dépasse, la consommation de gaz de ville d’ici à 2050. Les consommateurs y sont prêts, d’après une étude auprès de 800 habitants : « 95% des utilisateurs de gaz se disent prêts à consommer du gaz vert », résume le directeur régional.
Réseau GRDF et biogaz : vers 100 % de gaz renouvelable
Vincent Rozec est le chef du bureau d’exploitation, pierre angulaire du principal site régional de GRDF : « Ici se gère la sécurité du réseau breton. 24h/24, nous avons 35 personnes d’astreinte qui peuvent intervenir en moins d’une heure sur toute la région. » Outre les milliers d’interventions de sécurité, de dépannages, etc, le site pilote les flux dans les canalisations.
Garant aussi de la qualité du gaz, « nous analysons le gaz arrivant depuis les méthaniseurs. Il doit être équivalent au gaz qui circule dans le réseau. » Et en cas de problème sur ce plan, le service ferme les vannes à distance. Le Bex (bureau d’exploitation), « c’est la tour de contrôle des réseaux de distribution de gaz pour toute la région », compare David Colin.
Concilier une production assez constante et une consommation variable
« Un axe du quotidien au Bex est de favoriser la consommation locale du gaz produit localement », argue Vincent Rozec en présentant donc que l’équation se complexifie. Car l’adaptation, au-delà de raccorder des points de livraison dans des territoires plus ou moins proches des canalisations, consiste en une évolution de la gestion des flux. Quand le gaz venait uniquement du réseau de transport pour aller vers les consommateurs, « on s’assurait que la pression reste maximale. » Désormais, le réseau doit toujours acheminer le gaz vers le consommateur, mais en prenant une marge par rapport au plafond, afin d’absorber la production locale.
Si cette dernière, plutôt constante, se fait majoritairement en zone rurale, la demande est majoritairement l’affaire des villes et de leurs alentours. En outre, elle est à l’inverse très variable. David Colin illustre : « Il y a des périodes de moindre consommation où la production régionale de gaz vert représente 20 % du besoin en instantané. » Sur certains réseaux locaux déjà, les entrées peuvent même par moment dépasser la consommation. En conséquence, « en 2024, nous avons créé 120 km pour générer des possibilités d’écoulement, notamment pour mailler les différents réseaux de distribution, par exemple entre Janzé et Rennes », explique le responsable.
De plus, quatre points de rebours sont déjà en service sur la Bretagne. Ces équipements permettent d’envoyer du gaz vers le réseau de transport qui lui dispose d’une réelle capacité de stockage. David Colin précise : « Quatre autres points de rebours sont en construction. » Et dans un monde où les digesteurs de campagne auront totalement supplanté les cargos méthaniers, « il faudra en avoir une vingtaine. »
Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :