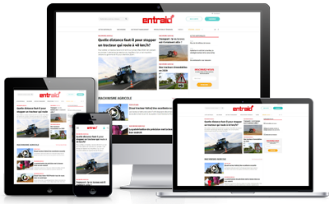Annabelle Revel, cheffe de projets « Agronomie, Agroéquipement, Environnement » à la Fncuma présente les résultats de l’étude Aliage (1), qui a pour but d’identifier des systèmes techniques collectifs innovants en matière de matériel et de techniques agronomiques pour se passer du glyphosate.
Quel est le but de cette étude qui dure trois ans et demi ?
L’objectif de ce projet est d’identifier les systèmes techniques sans glyphosate en grandes cultures sans labour et en viticulture en pente dans toute la France. Cela passe par l’identification d’innovations en matériel, en collectif et/ou en techniques agronomiques.
Nous avons remarqué qu’il existait de nombreux projets sur les systèmes agronomiques. Mais, ils prenaient en compte l’environnement de l’agriculteur. C’est-à-dire les échanges entre pairs, la spécialisation de certains salariés ou encore l’adaptation des outils. C’est cet ensemble que nous avons voulu étudier.
Comment se déroule-t-elle concrètement ?
Dans un premier temps, nous avons fait une traque à l’innovation. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur nos partenaires que sont l’Inrae et les écoles d’ingénieurs de Purpan à Toulouse et de l’Isara de Lyon. Ils se sont appuyés sur leurs réseaux pour trouver des agriculteurs, ou groupes d’agriculteurs, qui innovaient dans leurs pratiques afin de réduire leur utilisation de glyphosate.
En parallèle, nous avons cherché des cuma prêtes à intégrer des essais tout en étant accompagnées de leur animateur respectif. Ces derniers ont suivi une formation pour les mettre à niveau techniquement, mais aussi sur l’animation du groupe. Pour cette partie, l’idée était de faire émerger des groupes des idées afin de se passer de glyphosate. Nous voulions que toutes les possibilités soient envisagées, ouvrir toutes les alternatives. Nous avons identifié trois cuma, toutes situées dans le Grand-Est, deux en grandes cultures et la troisième en viticulture.
Quels sont les essais qui ont été suivis ?
La cuma viticole a testé le paillage des jeunes vignes. La seconde, tournée vers les grandes cultures, s’est appuyée d’un conseiller de la chambre d’agriculture locale pour établir un mélange d’espèces de couverts végétaux. La dernière a, quant à elle, revu son assolement en commun et a tenté d’évaluer l’impact de leurs nouvelles pratiques. Elles passent principalement par :
- Le semis direct ;
- Le décalage des dates ;
- La localisation de l’azote ;
- Moins apport d’engrais ;
- Le mélange de variétés ;
- L’ajout de légumineuses dans les couverts ;
- La culture de la luzerne dans la rotation.
Par ailleurs, sur le site expérimental de l’école de Purpan, les étudiants et chercheurs ont intégré la notion de réduction de glyphosate dans l’un de leurs systèmes testés. En effet, ils étudient l’impact de certains systèmes sur l’apport d’azote, d’intrants, d’eau, mais aussi sur les émissions de gaz à effet de serre. Ils y ont donc ajouté un test sur une absence de glyphosate.
Quels sont les résultats à six mois de la clôture de cette étude ?
Concernant la traque à l’innovation, seize entretiens ont été menés et plusieurs fiches techniques ont été réalisées. Nous avons réussi également à faire des liens entre les projets qui sont plus décentrés du glyphosate.
À l’image de l’expérimentation des étudiants qui va se poursuivre. Les résultats sont encourageants, car il existe bien des systèmes sans glyphosate. En revanche, elle est peu performante au niveau économique.
À l’issue des deux années d’essais menés par nos trois cuma, il est encore difficile de tirer des conclusions. Les agriculteurs avouent ne pas avoir trouvé de solutions pour le moment leur permettant de se passer du glyphosate. Deux ans ne suffisent pas pour tirer des conclusions, mais la dynamique est en marche.
Quelles suites donner à cette étude ? Quels sont encore les travaux à mener ?
Concernant l’accompagnement des cuma et groupes en général, la formation des animateurs va être peaufinée. En effet, ils sont nombreux à se montrer sceptiques quant à leur légitimité à parler d’orientation technique. Ce choix avait été fait pour éviter de cantonner les agriculteurs dans leurs réflexions. Mais l’ouverture des formations pour faire émerger les idées à des apporteurs de connaissances doit être envisagée. En revanche, la posture de cette personne doit laisser la place à toute idée, tout en accompagnant les groupes.
Sur le volet des expérimentations, les groupes sont lancés. Beaucoup assurent vouloir poursuivre les tests et pensent même à s’organiser en GIEE afin de capitaliser leurs connaissances acquises. Les cuma vont continuer de tester de nouvelles techniques et c’était bien le but de ces échanges.
Nous sortons d’un séminaire qui nous a permis de recentrer tous les résultats. L’objectif est qu’ils soient accessibles à tous, agriculteurs comme accompagnateurs. Les derniers mois seront mis à profit pour synthétiser et rédiger des documents utiles à tous.
(1) Etude réalisée grâce au financement du ministère de l’agriculture, menée par la fncuma et en partenariat avec Purpan, l’Isara, la Frcuma du Grand Est, l’ITAB et l’Inrae.
Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :