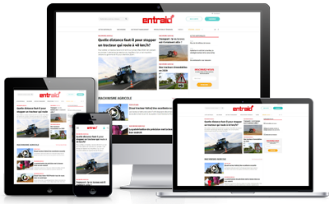« Allô, je suis bien à la fédération des cuma ? Oui, qu’est-ce qui vous arrive ? Je me suis installé il y a deux ans, j’ai acheté pas mal de matériels à cette occasion. Là, j’ai des aléas climatiques depuis deux ans et les annuités pèsent. Or, je m’aperçois qu’il y a une cuma à 2 km de mon exploitation qui a un tracteur de 140 ch. Ce dernier pourrait me convenir pour pas mal de travaux. Est-ce que j’ai le droit d’adhérer maintenant ? « Cette conversation n’est pas un fantasme d’animateur de fédération de cuma. Elle fait son chemin, tranquillement, parmi les demandes qui atterrissent au standard de la fédération tarnaise. Retour sur le diagnostic de mécanisation agricole et les ressources initiales des cuma.
Trop tard ?

De gauche à droite, le trésorier de la cuma de Saint-Matré, Lionel Semenadisse, la présidente, Claire Ghilbert, et la secrétaire, Évelyne Demeaux-Levy.
« On voit des jeunes qui s’embarquent dans des stratégies d’installation et de mécanisation en individuel. Malheureusement, ils identifient les cuma de leur secteur un peu tard, note Daniel Fabre, le directeur. Ils se demandent, après coup, comment articuler la stratégie d’équipement sur leur exploitation et avec les équipements disponibles dans les cuma des alentours. »
Dommage, pas mal de frais auraient pu leur être évités… sans compter la possibilité de rencontrer rapidement d’autres agriculteurs de leur secteur.
Un nouveau développement législatif devrait toutefois réduire la fréquence de ce type de situations. La loi d’orientation, votée le 20 février 2025, rend en effet obligatoire un diagnostic modulaire avant installation. L’un de ces modules va concerner d’ailleurs la stratégie de mécanisation.
Diagnostic de mécanisation agricole pour tous
Le réseau des cuma est en position d’expertise sur ce thème : ses animateurs agroéquipement, nombreux en Occitanie, sont en possession des chiffres et des données du réseau cuma.
Ils animent déjà dans certains départements des formations lors des stages 21 h, lors du parcours d’installation, pour fournir aux candidats des repères sur leurs futures charges de mécanisation, à l’aide des diagnostics Mécagest et Mécaflash.
L’occasion de simuler plusieurs stratégies pour comparer les charges, les revenus et l’organisation du travail. Mais aussi de se comparer avec des repères sur des exploitations semblables.
Le cas du tracteur
Ce n’est pas un hasard si les appels au standard du Tarn concernent en priorité la possibilité d’adhérer à une activité de traction. Le tracteur pèse très lourd dans les comptes d’une exploitation.
Si l’on décortique les postes de charges d’une exploitation, les charges de mécanisation dans leur ensemble représentent, toutes filières confondues, entre 20 et 40 % du total.
Et la traction en elle-même constitue en moyenne la moitié de ces charges. Sachant que le tracteur de tête est la fois celui qui coûte le plus, et qui est utilisé à pleine puissance à peine un tiers du temps total de son utilisation en moyenne.
La « bamba » ou la « pampa » ?
Toutefois, l’apport du groupe d’agricultrices et d’agriculteurs ne se cantonne pas qu’à la maîtrise des charges de mécanisation.
« La question de la cohabitation des générations d’agriculteurs, et du renouvellement, ne se limite pas à la question économique », analyse Didier Larnaudie, président de la fédération des cuma de l’Aveyron.
Elle concerne la viabilité des zones rurales, au sens le plus large :
- vivre ;
- Échanger ;
- Progresser ;
- Passer du temps ensemble ;
- Éventuellement embaucher un salarié ;
- Etc.
« C’est aussi pouvoir s’organiser et se dégager du temps pour faire autre chose que travailler. On ne peut pas imaginer des agriculteurs, même jeunes, même très compétents et motivés, seuls au fond d’une pampa, » analyse-t-il.
Il y va aussi de l’intérêt de la cuma, indique Sylvain Mervoyer, administrateur à la fédération des cuma de l’Aude : « Modifier son fonctionnement pour accueillir de nouveaux installés, qu’ils soient des profils traditionnels, ou hors-cadre, ou non issus du milieu agricole, ça remet de la dynamique dans les cuma. »
Viabilité des projets
Raymond Llorens, président de la fdcuma Gard-Hérault, met en garde contre la tentation de l’équation ‘un départ = une reprise’. « Bien sûr, il faut que les territoires ruraux comptent une densité d’actifs suffisants. Mais dans certains secteurs ou certaines filières, l’agrandissement peut permettre de rendre viable certaines exploitations qui étaient ‘limite » », analyse le viticulteur. « C’est à analyser au cas par cas, sans dogmatisme, » pose-t-il.
Argument repris par Éric Encausse, président de la FR Occitanie : « Il faut s’interroger sur la pérennité des projets de reprise. » Et en l’occurrence, le réseau des cuma a bien identifié le potentiel des salariés agricoles et de ses propres salariés dans la solidité de ces projets d’installation.
Un poste d’action idéal
Les cuma, positionnées au cœur de l’activité agricole, et non en périphérie, constituent donc bien un poste d’action idéal pour repérer les futurs cédants… et bien souvent les potentiels repreneurs. Elles y ont aussi intérêt, car pour maintenir leurs tarifs, elles doivent pérenniser les surfaces sur lesquelles évoluent leurs matériels, leurs volumes d’activité, voire les amplifier au vu des augmentations des prix des matériels agricoles.
C’est sur ce constat qu’ont été organisées en octobre 2024 les Journées « Renouvellement des générations en Agriculture » du Sud-Ouest, conjointement par les Fédérations régionales des cuma d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Elles ont permis de dégager une liste d’actions efficaces à lire ci-contre, résumé par Viviane Le Clerc, de la Fédération des cuma de Nouvelle Aquitaine pour permettre aux responsables, mais aussi aux adhérents de cuma, de favoriser la transmission des exploitations dans leur secteur.
Manière, même si beaucoup d’acteurs gravitent autour du thème de l’installation, comme l’analyse Cécile Gazo, de remettre l’initiative des agriculteurs au centre de ce dossier.
Mécagest, comment ça marche ?
Le logiciel Mécagest est un outil qui permet d’évaluer les charges de mécanisation d’une exploitation agricole assez précisément à partir de quelques données simples (productions, surfaces, équipement…) et des comptabilités des exploitations.
Ces sessions se déroulent sous forme de courtes formations. Elles se pratiquent en groupes d’agriculteurs, secondés par un animateur machinisme du réseau cuma. En complément, l’animateur peut proposer d’appliquer l’outil Mécaflash, qui permet à l’agriculteur de comparer son niveau de charges de méca à celui d’exploitations similaires en taille et productions.
L’animateur peut ensuite construire avec chaque agriculteur des scénarios pour réduire les charges de mécanisation. Cet accompagnement repose toujours sur la stratégie de l’agriculteur. Et ce ne sont pas toujours les pistes « cuma » qui sont conseillées. Parfois, il peut s’agir de :
- Copropriété ;
- Achat d’occasion ;
- Location de matériels.
L’important, c’est de réduire les charges de mécanisation qui gonflent encore aujourd’hui avec l’augmentation des prix des matériels et du carburant. Les formations Mécagest s’adressent à tous les agriculteurs, à tout moment de leur parcours, et sont finançables à 100 % par le fonds de formation Vivea.
Les animateurs ‘machinisme’ d’Occitanie les proposent de façon de plus en plus systématique aux Jeunes agriculteurs. Ces derniers bénéficient d’une bonification de la DJA lorsqu’ils s’engagent à la suivre. Cela permet éventuellement de « recalibrer » leur projet.
En pratique, comment assurer le renouvellement des adhérents ?
- Maintenir la cuma attractive = matériel renouvelé et entretenu + autres services : salarié/traction/hangar ;
- Interroger le sujet lors des renouvellements de matériels ;
- Faciliter l’adhésion (période probatoire, étalement du paiement du capital social…) ;
- Se renseigner sur les nouveaux agriculteurs sur le territoire ;
- Responsabiliser les adhérents sur la continuité de l’activité ;
- Envisager de revoir le fonctionnement de la cuma ;
- Transmettre les valeurs de la cuma ;
- Répartir les tâches/l’organisation.
Quand un adhérent quitte la cuma
- Identifier le motif (retraite, cessation d’activité, volonté personnelle) ;
- Identifier les démarches à faire par la cuma et les conséquences sur le fonctionnement ;
- En cas de départ, y a-t-il un repreneur ? ;
- Interroger la personne sur sa perception de la cuma ;
- Réunir le conseil d’administration.
Quand un nouvel adhérent arrive
- Présentation de la cuma et des membres ;
- Signature de l’engagement et du règlement intérieur ;
- Validation du CA ;
- Entendre le projet (les projets) du nouvel adhérent ;
- Anticiper l’organisation des chantiers ;
- Donner du temps de parole en AG ;
- Prévoir un temps de convivialité.
Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com