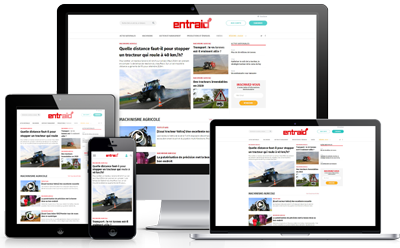Votre métier est d’apporter des outils aux éleveurs et donc de connaître leur besoin. Vers quoi évolue-t-il ?
Quand on regarde chez nos éleveurs pour savoir ce dont ils ont besoin, nous constatons qu’il y a quelque chose qui monte indéniablement: c’est la culture des légumineuses. Pour produire de l’énergie dans les fourrages, il n’y pas de souci. De la protéine, on savait moins bien faire. Mais au regard de l’évolution des marchés aujourd’hui, un défi est de réduire la dépendance des élevages par rapport au tourteau de soja, par exemple. Si on veut le relever, les légumineuses sont un moyen. Avec, on peut équilibrer ses rations. C’est possible et ça marche.

Olivier Coutreau, chef de produits fourragers chez Barenbrug.
Vous avez un exemple en particulier ?
Facile et immédiat. L’éleveur peut déjà mettre de la légumineuse dans ses ray grass. Nous travaillons en ce sens, sur des légumineuses annuelles, pour apporter de la protéine dans des stocks de type ray grass d’Italie. Aujourd’hui, il se vend du trèfle incarnat pour cet usage. Cultivé sur un hectare, c’est un équivalent à 700 ou 800kg de tourteau de soja. Les légumineuses sont aussi une base des prairies multi-espèce, un sujet sur lequel les connaissances avancent…
Et il y a encore beaucoup de choses à faire pour assortir les plantes en vue d’augmenter la production, développer la résistance aux récoltes, ou encore étaler la production du mélange sur la saison. Ces mélanges se réfléchissent au niveau de la variété, pas seulement de l’espèce. Car un bon mélange ne peut se faire qu’avec des bonnes variétés et qui vivent bien ensemble.
Pour l’avenir, que nous réservent les semenciers? Une plante fourragère miracle?
La plante miracle n’existe pas. Nous avons en France suffisamment de diversité et de ressources dans nos espèces existantes pour mettre en place et faire des choses. On est loin d’être au bout de la sélection variétale ou d’avoir à utiliser des OGM pour continuer d’avancer. Chose certaine, les éleveurs ont besoin de plantes adaptées à leurs conditions et ce qui est valable ailleurs n’est pas forcément valable en France. C’est tout l’intérêt de disposer d’un label spécifique à la prairie de France. Pour l’éleveur, le sigle France Prairie garantit, grâce aux validations apportées par Arvalis, que le mélange qu’il achète correspond à ce dont il a besoin.
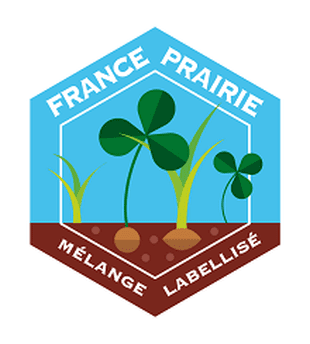
Pour Olivier Coutreau, « le sigle France Prairie garantit, grâce aux validations apportées par Arvalis, que le mélange qu’il achète correspond à ce dont il a besoin».
| Un aliment sain qui valorise les terres moins favorables Il y a dix ans, le sorgho fourrager «en était à ses balbutiements.» S’il parle au passé, c’est parce qu’Olivier Coutreau constate une franche évolution. Avec l’arrivée du gêne BMR, «on arrive à des niveaux d’UF de 1», semblables au maïs, du fait d’une cellulose plus valorisable par les animaux. Avec le maïs, l’apport d’énergie se fait sous forme d’amidon. «Les animaux sont en risque d’acidose régulier», résumé-t-il. Le sorgho, en diluant l’amidon, diminue ce risque, sans diluer l’énergie. Le sorgho a un effet sur la santé, qui peut se traduire sur les indicateurs de reproduction. Souvent, «l’éleveur gagne aussi sur les taux», et la plante ouvre des solutions agronomiques. Il valorise des terres ayant de faibles réserves d’eau. «On peut y faire un méteil, puis un sorgho.» Ce dernier ne souffre pas d’une réserve hydrique moindre et d’une date de semi plus tardive. Ainsi, «cela donne deux cultures qui sortent un tonnage intéressant.» Le sorgho «montera en puissance.» Néanmoins, Olivier Coutreau n’imagine pas qu’il supplante le maïs. Sauf en conditions très séchantes, il le voit plutôt comme un complément possible au maïs. Pour la performance zootechnique, il conseille un minimum de 20 % de sorgho, qu’il préfère cultivé séparément du maïs. Dans l’état actuel des connaissances et de la maîtrise technique, «la culture associée maïs-sorgho me gêne un peu, dans le sens où l’itinéraire se cale sur la précocité du maïs.» Le sorgho a une dynamique différente. Il peut gagner «énormément de volume en fin de cycle», qualité qu’il ne peut exprimer avec une récolte précoce. |
Retrouvez l’intégralité du hors-série élevage paru en avril 2017 en version numérique.