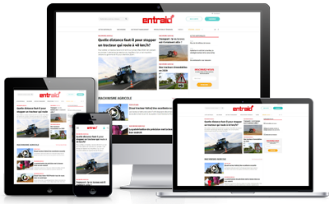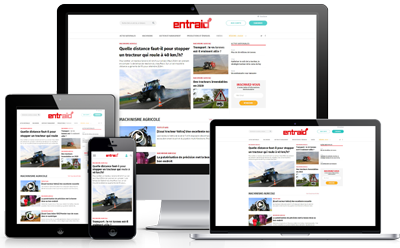« On est dans un basculement depuis 5 ans en matière d’évaluation des risques », confirme le chercheur à l’Institut de la recherche agronomique Jean-Pierre Cravedi.
Une nouvelle notion a émergé, « l’exposome », c’est-à-dire la totalité des expositions d’un individu à des facteurs environnementaux au cours de sa vie, en commençant par le foetus.
Nous sommes soumis au cours de la vie à plus de 100.000 substances chimiques auxquelles s’ajoutent les toxines naturelles (provenant des champignons) et les substances « néoformées », c’est-à-dire issues des processus de transformation et de préparation des aliments.
Pour mesurer la toxicité, la méthode éprouvée jusqu’à présent consiste à tester le produit à plusieurs doses sur l’animal, typiquement le rat. On en tire des « doses journalières admissibles » et des « doses journalières tolérables », pour qualifier la quantité de substance chimique pouvant être ingérée quotidiennement sans risque appréciable.
Mais la méthode a ses limites en matière de coût (un test de cancérogénicité coûte plus de 700.000 euros et dure 2 ans) et utilise beaucoup d’animaux de laboratoire (quelque 500.000 par an en Europe en 2011).
En outre, « dans la vraie vie », nous ne sommes pas exposés à un, mais à des quantités de substances qui interagissent, note Jean-Pierre Cravedi.
Or, « on en est au tout début de la mesure des expositions prévisibles », constate-t-il.
Les nouvelles méthodes toxicologiques s’appuient sur l’étude in vitro, la biologie moléculaire et la bio-informatique: « les tests de criblage à haut débit permettent 1,5 million de mesures par jour, on est en train de constituer des bases de données considérables », explique-t-il.
Problème: ces approches haut débit basées sur des tests in vitro sont capables de renseigner sur les dangers d’un nombre encore limité de substances, et demandent souvent à être confirmées par des tests animaux.
Mais « d’ici quelques années l’évaluation du risque sera plus sûre », affirme-t-il.
L’intestin, « muraille de Chine » du système immunitaire
Les récentes études de l’Inra sur les contaminants alimentaires montrent l’urgence de telles mesures: en juin des chercheurs ont constaté l’effet d’un cocktail de pesticides utilisés dans les pommeraies sur le rat mâle: surpoids, développement de maladies métaboliques telles que l’obésité et ses complications.
En passant sous revue 78 études liées à l’impact de mélanges de pesticides sur des modèles animaux et humains, les chercheurs ont trouvé que dans seulement 15% des cas il n’y avait pas d’effet combiné. 48% des effets cocktails étaient dus à une addition de doses et 35% à des interactions.
Les nanoparticules présentes dans les additifs, les emballages et étiquettes de l’alimentation ne sont pas moins inquiétantes. Pour Eric Houdeau, qui a mis en évidence la toxicité de l’additif E171 en 2017 (dioxyde de titane), « on s’aperçoit que ce sont des millions de particules qui passent la barrière de l’intestin ».
Or, l’intestin est en quelque sorte la « muraille de Chine » de notre système immunitaire, observe-t-il. Lorsque des nanoparticules passent cette barrière et aboutissent dans la rate, elles sont susceptibles de fragiliser le système immunitaire et d’exacerber les inflammations.
Un autre danger provient des mycotoxines produites par les champignons, présentes à l’état naturel dans 50% des sources alimentaires au niveau de la planète. La plupart des études, là encore, mesurent l’effet toxique d’un composé seul, et non les mélanges « cocktails ».
Isabelle Oswald, lauréate du Grand prix de la recherche de l’Inra 2018, a montré un effet de synergie de ces toxines à faible dose et des interactions avec les métaux lourds, également présents dans l’alimentation.