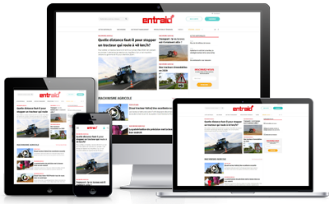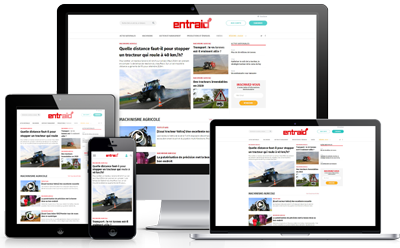A la cantine de l’école primaire Renaudel de Montrouge (Hauts-de-Seine), des fours réchauffent à 140 degrés des repas en barquettes fabriqués et conditionnés un à trois jours auparavant, dans une « cuisine centrale » qui dessert des dizaines d’écoles d’Ile-de-France.
En France, les repas servis dans les cantines scolaires représentent près d’un tiers de la restauration collective.
Et 41% de ce marché de 21,1 milliards d’euros annuels, selon Gira Foodservice, est confié à des sociétés dans le cadre d’une gestion « concédée » plus économique, en vogue depuis 30 ans, au détriment de la gestion directe des cantines par les collectivités.
Filiale du britannique Compass, Scolarest, n°3 en France derrière les géants Sodexo et Elior, sert quelque 400.000 repas par jour dans 500 établissements scolaires, dont 3.500 dans les 19 écoles et crèches de Montrouge.
Alors que le projet de loi agriculture et alimentation, qui sera adopté mardi à l’Assemblée, veut imposer d’ici à 2022 50% d’alimentation de qualité, labellisée et locale, dont 20% de bio en restauration collective publique – hors écoles privées -, les villes ayant concédé la restauration scolaire modifient le cahier des charges de leur prestataire.
C’est le cas à Montrouge, qui a fait ce choix il y a des années pour des raisons « de normes, d’hygiène, de sécurité de fabrication et de productivité », affirme son maire (UDI) Etienne Lengereau.
Lors du renouvellement du marché pour quatre ans cet automne, la ville a demandé pour un prix identique, 20% de bio en 2022, 20 à 30% de local et des barquettes en cellulose au lieu de plastique.
« Un quart des clients sont très exigeants, comme Montrouge », les autres « s’en tiennent au réglementaire » notamment les communes aux « contraintes budgétaires fortes », explique la directrice générale de Scolarest, Isabelle Monnet.
« Aucune exigence »
« Depuis un ou deux ans, la demande est plus large et les gros acteurs de la restauration collective y vont: le bio leur fait remporter des appels d’offres. Il y a encore cinq ans ils traînaient les pieds en disant +Ca ne va pas être possible, il va falloir importer, ça va coûter cher, nos clients n’en veulent pas+ », se souvient Florent Guhl, directeur de l’Agence bio.
Le bio ne représente encore que 3% des 3,7 milliards de repas servis chaque année en restauration collective en France: hôpitaux, maisons de retraite, entreprises, scolaire, et 4,5% dans les écoles.
Ce faible taux n’est pas lié à des problèmes d’approvisionnement, affirme Jean-Michel Noël, responsable du bio chez Sodexo, qui fournit 250.000 repas par jour dans 490 écoles maternelles et primaires. « Certains de nos clients n’ont aucune exigence en la matière », dit-il.
Pour réduire les 10% de surcoût attribuable aux 20% de bio, selon M. Noël, Sodexo se fournit directement auprès de coopératives agricoles.
Il a aussi commencé « à titre expérimental », à soutenir des fermes des Pays-de-Loire qui passent au bio en leur achetant – comme le prévoit la nouvelle loi – au prix du bio, leur production pendant la période de « conversion », où ils n’utilisent plus de pesticides mais n’ont pas encore le label.
Car « entre bio et conventionnel, l’écart de prix varie d’un produit à l’autre », dit Mme Monnet. Mais « plus la matière première est de qualité, meilleur est son rendement »: la viande bio réduit moins en cuisant, ce qui compense la différence de prix.
Autre levier, diminuer le gaspillage: les collèges de la Drôme qui atteindront 30% de bio dès fin 2018, ont sensibilisé leurs élèves.
« En jetant moins, ils économisent de quoi acheter des aliments de meilleure qualité » démontre M. Guhl. Ces établissements, en gestion directe, se sont rapidement mobilisés. « Cela coûte plus cher mais donne aussi de l’emploi sur un territoire ».